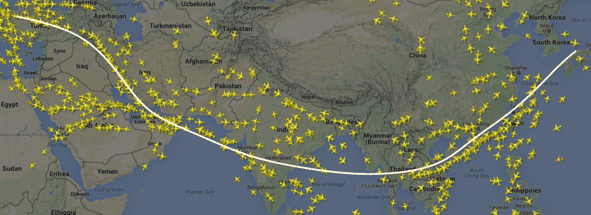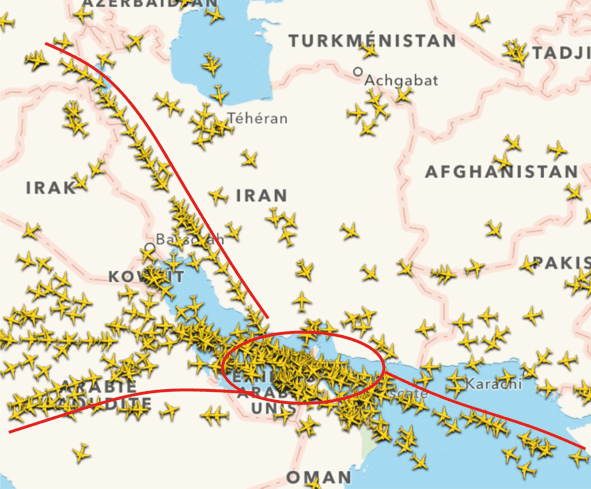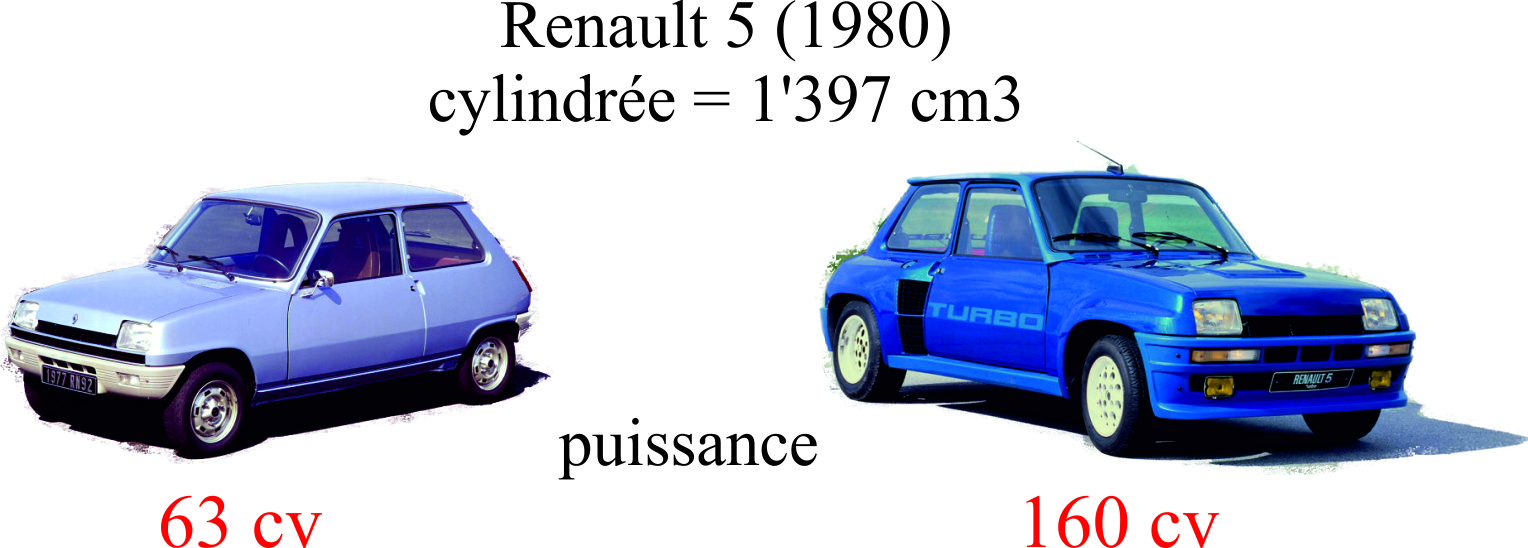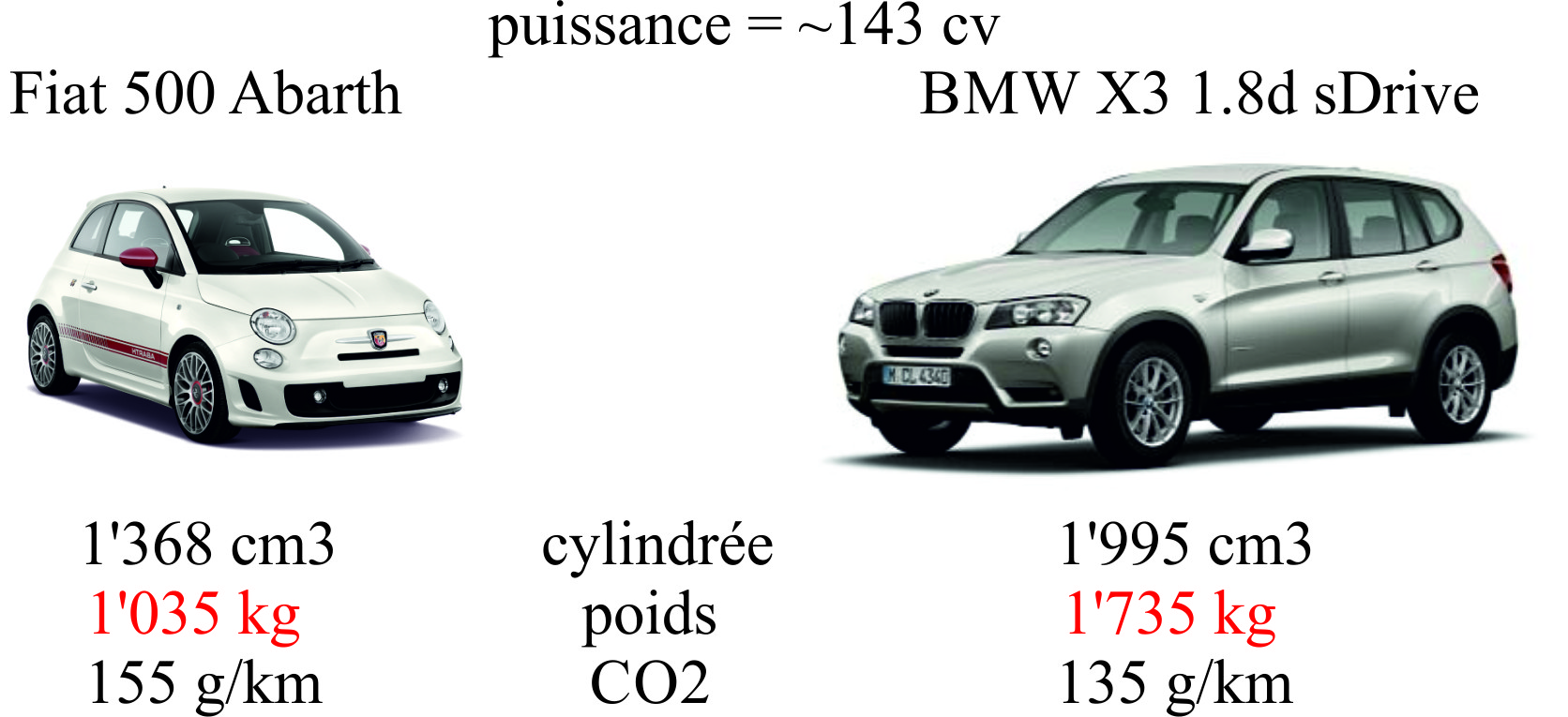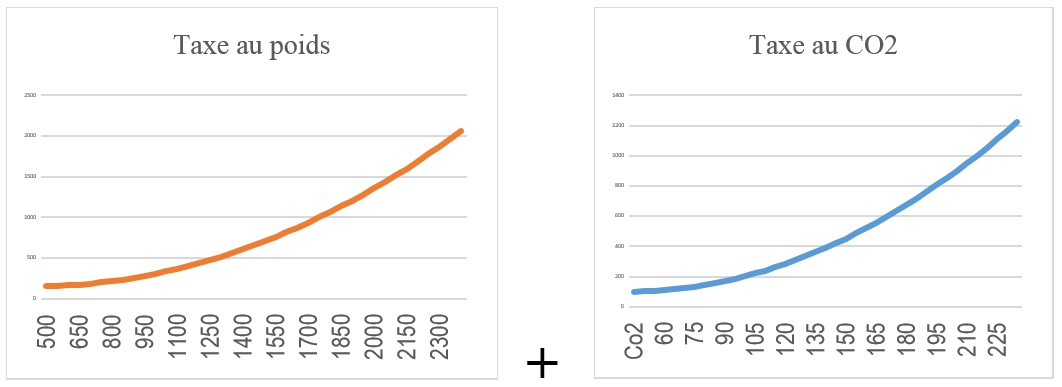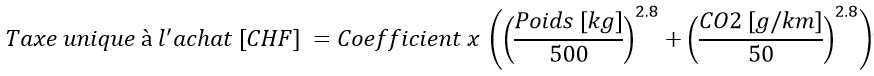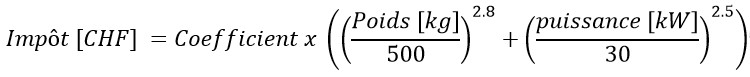Une étude de Gallup affirme qu’en France et en Allemagne, seule une dizaine de pourcent des salariés sont engagés dans leur entreprise, tous les autres subissent leur sort avec un degré de désintérêt plus ou moins marqué.
Nous ne pouvons qu’être interpellés par les conclusions : 10% de l’effectif s’engage pour faire avancer l’entreprise alors que 90% des personnes restantes sont désengagées au travail.
De ces personnes désengagées, 60% ne sont présents que pour des raisons alimentaires et 30% ont un mal-être si profond qu’ils en deviennent nuisibles pour leur environnement.
Si ces chiffres sont exacts, cela signifierait que les entreprises sont des usines à créer de la frustration. Voilà un paradoxe alors que toutes prétendent rechercher des collaborateurs créatifs et talentueux.
Structures pyramidales
Les structures organisationnelles sont abondamment étudiées dans la littérature spécialisée et offrent divers modèles, cependant, il semble que les structures hiérarchiques figées soient encore dominantes. Ces organisations sont caractérisées par des chaines de commandement à étages multiples et une grande centralisation du pouvoir.
Les structures hiérarchiques vont de pair avec la taylorisation du début du XXème siècle. L’organisation scientifique du travail préconise de diviser le travail en de multiples tâches répétitives, cadencées par une chaine de production dont Charlie Chaplin a si bien caricaturé les excès.
Cette organisation du travail a l’avantage de canaliser les ressources brutes. Elle est adaptée aux industries de production de masse comme aux structures militaires traditionnelles.
Souvent qualifiée d’inhumaine, la taylorisation exige des ouvriers dociles et corvéables pour des tâches inintéressantes et abrutissantes organisées par une structure supérieure. On parle d’aliénation du travail.
Ces structures perdurent aujourd’hui sous des formes un peu plus évoluées. Des décisions et missions sont prises en haut lieu, la transmission percole dans les strates hiérarchiques avec une perte de sens au fil de la diffusion.
In fine, les collaborateurs effectuent le travail dont ils ont reçu l’ordre sans franchement en connaitre le sens ou la finalité et probablement avec la conviction que certaines tâches ne font aucun sens.
La déresponsabilisation qui en découle génère des frustrations qui au mieux débouchent sur un désengagement et au pire sur de la résistance.
Voilà ce qui pourrait en partie expliquer le faible niveau d’engagement constaté par l’étude précédemment mentionnée.
Le dysfonctionnement
La conséquence de ce type d’organisation est un rendement net très faible. D’importantes ressources sont employées pour une production peu satisfaisante. On pourrait croire que le faible rendement et un environnement peu exigeant auraient le mérite de préserver les collaborateurs mais ce n’est manifestement pas le cas !
Lorsque les moyens sont abondants, les éventuelles carences de productivité peuvent être comblées par l’ajout de ressources. Ces nombreuses ressources devant bien entendues être gérées par une cohorte de chefs à tous les niveaux.
Tout se gâte quand les moyens financiers ne suffisent plus à nourrir la machine et que le mot efficience devient une exigence.
Le propriétaire fait le constat d’inefficience et exige un meilleur rendement. Le premier réflexe est bien entendu un renforcement du contrôle pour vérifier que tout le monde travaille dur.
Et c’est ainsi que les contrôleurs de tous bords interviennent avec des missions parfois floues mais qui exigent leurs lots de changements pour justifier leur action.
Rapports, reporting, audits et séances, occupent tout ce petit monde au nom de la quête d’efficience. Ainsi tous auront des journées bien remplies pour effectuer des tâches improductives.
Cependant, la productivité globale aura toutes des chances de baisser ce qui exaspérera le propriétaire qui commandera de nouveaux contrôles et de nouvelles mesures qui ne manqueront pas d’augmenter le rapport de défiance.
Pour leur part, les collaborateurs de terrain vont subir des réformes imposées par la hiérarchie, alors que leur finalité sera floue. Il se verront ajouter dans leurs pratiques bon nombre d’opérations liées aux contrôles et aux statistiques dont ils savent pertinemment qu’elles ne seront pas exploitées.
En définitive, c’est par la contrainte que la hiérarchie espère imposer une augmentation de la productivité. Tenter d’imposer de nouveaux objectifs de performance à des employés dont l’écrasante majorité est désengagée a peu de chance de faire des étincelles.
La spirale infernale est bien engagée. La société du contrôle ne fonctionne pas et pourtant, nous répétons les mêmes comportements. Souvenons-nous de l’affirmation d’Albert Einstein « la folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent ».
Alors que faire ?
Changer ?
Plusieurs raisons m’incitent à questionner nos organisations et trouver de nouvelles voies.
La première est simplement le constat d’échec du modèle actuel qui montre ses limites avec une incapacité à évoluer pour répondre aux nouveaux besoins.
La seconde raison concerne notre environnement qui se complexifie et demande de l’agilité, de l’initiative et de l’intelligence.
Or, nous savons que les organisations fortement centralisées et segmentées par fonction correspondent à des environnements stables et homogènes ce qui caractérise de moins en moins nos environnements actuels.
Par exemple, une armée traditionnelle est structurée pour livrer un combat sur un front qui oppose des forces humaines et matérielles. En revanche, elle ne peut rien contre la guérilla qui est mobile, imprévisible et agile. Ses chaines de commandement et ses forces sont impuissantes face à ce type d’attaque.
La troisième raison concerne les moyens financiers. Dans un monde globalisé où règne une forte compétition, il est demandé à tous de produire des biens et des services de qualité aux coûts les plus justes. Les rentes de situation sont de plus en plus rares et seront de moins en moins durables, quels que soient les acteurs et les secteurs.
La quatrième raison est humaine. Créer des générations de collaborateurs désengagés n’a pas de sens d’autant que ce mode de fonctionnement crée de la frustration voire de la misère.
Alors qu’il est impératif de créer de la valeur, il est irresponsable de gaspiller les ressources à disposition.
La cinquième raison est générationnelle, il sera vraisemblablement compliqué d’attirer des collaborateurs issus de la « génération Y » qui ne montreront aucune loyauté à des organisations peu motivantes.
Objectifs vs contrôles
La culture du contrôle, dans une hiérarchie figée n’a aucune chance de produire un résultat probant. Par conséquent il est intéressant d’imaginer d’autres modèles.
Une des pistes pour augmenter l’efficience du système est de diminuer la proportion de collaborateurs désengagés. Cet axe semble même prioritaire tant il est une source d’améliorations.
Pour défendre la piste des collaborateurs, retenons trois critères de la pyramide des besoins établie par Maslow :
- Le besoin d’accomplissement de soi
- Le besoin d’estime
- Le besoin d’appartenance
Le besoin d’accomplissement est un moteur qui permet à chacun de réaliser et se réaliser dans une activité.
Le besoin d’estime concerne notamment le respect de soi, la reconnaissance et l’appréciation des autres. Or ces aspects ne sont pas valorisés lorsque les collaborateurs sont de simples exécutants à qui on impose des pratiques pour effectuer des tâches auxquelles ils ne trouvent pas de sens.
Enfin le besoin d’appartenance consiste à se sentir bien avec les autres dans son environnement de travail. Construire ensemble est un moteur certainement plus productif que subir individuellement.
Dès lors, l’objectif est de mettre les gens en mouvement et tendre vers le plaisir et la satisfaction dans l’accomplissement de son travail.
Pour cela nous allons faire les hypothèses suivantes :
- Les collaborateurs connaissent leur métier,
- Les collaborateurs sont intelligents,
- Les collaborateurs heureux sont motivés.
Mais pour quoi faire ?
Cette question est centrale et beaucoup moins anodine qu’elle ne parait.
Demander aux collaborateurs d’organiser librement leur travail (soyez des entrepreneurs) est une fausse bonne idée car il y a toutes les chances pour qu’ils privilégient leur propre confort au détriment de la satisfaction du client.
Afin d’éviter ce travers, il s’agit de fixer des objectifs. Cette évidence n’en est pas une quand on se souvient des déclarations de Peter Drucker, le pape du management : « l’administration par objectif est efficace si vous connaissez les objectifs. Mais 90% du temps vous ne les connaissez pas. »
Voilà le véritable enjeu de l’organisation : fixer des objectifs clairs, mesurables, réalistes et qui font du sens. La définition des objectifs devrait être la seule préoccupation du management.
Charge ensuite aux collaborateurs d’organiser le travail en fonction des objectifs fixés et mesurés.
Avec des objectifs clairs, les collaborateurs devront s’engager et retrouveront une motivation dans leur travail. Ils choisiront des solutions pertinentes en fonction de leurs connaissances du métier.
A ce titre, la satisfaction des collaborateurs doit être un objectif à part entière, également mesuré.
Parmi les objectifs fixés, il en est un qui devra être priorisé par le management : la satisfaction client.
Une véritable culture de la satisfaction doit être entreprise, notamment en identifiant ce qui constitue des motifs de satisfaction.
Un objectif n’est pas une cadence (p.ex traiter 100 clients à l’heure au guichet), mais plutôt un critère lié à la satisfaction (p.ex. délai d’attente au guichet de moins de 10 minutes et expérientiel agréable). En effet, la première proposition n’interroge pas le processus, elle ne fait que pressuriser sans mettre de sens. La seconde proposition est un objectif qui ouvre la possibilité aux collaborateurs d’organiser la façon dont le service est délivré, par exemple en simplifiant des processus qui ne font pas de sens ou en automatisant certaines tâches.
Un accompagnement pour atteindre les objectifs doit rester possible. Ce sont les collaborateurs qui demandent cas échéant le support organisationnel dont ils ont besoin. Il s’agit là d’une mise en œuvre concrète du « management participatif ».
Une autorité de surveillance telle qu’une « cour des comptes » pourrait mettre ses compétences au service d’un accompagnement dans la mise en œuvre de processus. De surveillance on passe à accompagnement délibéré ce qui change notablement la perception.
Si nouveau que cela ?
Les pratiques évoluent et l’organisation mécaniste dans une structure fortement hiérarchisée a vécu.
Certaines entreprises dans les technologies de l’information ont institué des espaces de liberté qui permettent à chacun de développer des projets personnels dans l’entreprise. Non seulement ils disposent de temps mais ils peuvent également mobiliser des ressources internes d’accord de participer à un projet motivant sur leur temps officiellement libéré.
Les résultats en termes de créativité et de produit sont un des moteurs de l’innovation de sociétés telles que Google.
Des nouvelles pratiques intéressantes apparaissent et, sous la bannière du « bonheur au travail », un certain nombre d’exemple montrent des pistes intéressantes et probantes.
Ce sont celles qui ont permis à des entreprises telles que Harley-Davidson de connaitre le succès après des années de déclin. Ces démarches sont également expérimentées avec succès dans les administrations publiques, notamment en Belgique par la sécurité sociale et le ministère des transports.
Il semble que le temps est venu d’éradiquer les logiques de défiance et de lutter contre le mal-être au travail qui ne profite à personne.
Créer du plaisir et du sens dans les activités professionnelles sont des pistes qui méritent d’être sérieusement évaluées pour remettre une organisation en mouvement et au service de tous ceux qui gravitent autour.
© Pascal Rulfi, janvier 2016
Téléchargez l’article : Organisation et travail